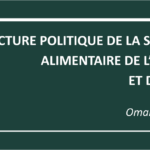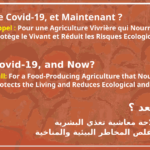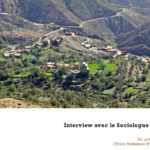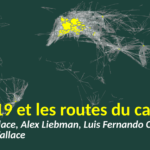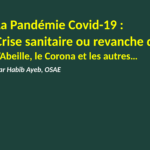Max Ajl s’est entretenu avec l’économiste marxiste Utsa Patnaik sur l’histoire agraire et l’impérialisme. Les travaux de Patnaik sur l’histoire économique de l’Inde et d’autres pays sous domination coloniale montrent en quoi cette expérience a accentué l’insécurité alimentaire et le chômage, des tendances qui ont de nouveau émergé sous le néolibéralisme. Cet entretien a été réalisé au sein de l’atelier « Agriculture and Imperialism », organisé par le Thimar Collective, en novembre 2018, à Beyrouth au Liban et a été initialement publié dans la Review of African Political Economy.
Continuer à lirePublications
Une lecture politique de la sécurité alimentaire de l’Algérie et du Liban
Les crises, qu’elles soient de nature économique, financière, sanitaire ou politique, ont cette capacité à rendre plus lisible ou visible les vulnérabilités ou les menaces alimentaires qui se profilent dans les pays concernés. Il en a été ainsi de la crise sanitaire dans un certain nombre de pays d’Europe qui ont mesuré les effets des délocalisations de leurs productions agricoles. Les appels à une souveraineté alimentaire impliquant des politiques agricoles nationales volontaristes et le retour vers des systèmes alimentaires territorialisés ont été affiché par les milieux agricoles, les organisations de la société civile et politique et les cercles académiques. La FAO, le PAM et toutes les organisations des Nations-Unis ont, pour leur part, multiplié les alertes relatives à une crise alimentaire, voire une famine, pouvant affecter les pays pauvres et l’Afrique en particulier.
Continuer à lireTigouliane au croisement du Covid.19 et de la sécheresse
Croyez bien en l’immensité de ma joie de vous savoir ravis de votre séjour à Tigouliane. Mais sachez que derrière le sourire affiché par les femmes et les hommes de Tigouliane2, sourire qui vous a tant émerveillé, se cachent des natures résignées à leur sort et acceptant la fatalité. L’expression usitée Ghayda Youmar Rabbi, « ce que Dieu a ordonné » résume l’état d’esprit des gens. Et c’est de cet état d’esprit, enchâssé dans un faisceau de contraintes et d’espoir que je vais parler.
Continuer à lireAppel : Le Covid-19, et Maintenant ?
Appel pour une Agriculture Vivrière qui Nourrit les Humains, Protège le Vivant et Réduit les Risques Ecologiques et Climatiques
Continuer à lireIncidences de l’investissement foncier agricole sur les sociétés rurales – À propos de « la classe moyenne agricole »
La question du foncier agricole au Maroc est centrale dans les agendas politiques. La dernière stratégie de développement agricole, Génération Verte, projette de mobiliser/valoriser un million d’hectares de terres collectives, les distribuer aux ayant-droits de ces terres et à des investisseurs, dans la perspective de créer une « classe moyenne agricole ». L’intention est d’alléger les disparités sociales dans le milieu rural et instaurer un peu de justice sociale. L’article émet l’hypothèse que ces terres seront prises sur les parties du parcours susceptibles d’être cultivées. La nouvelle législation sur la tutelle administrative facilitera les procédures de leur acquisition. Mais la faisabilité de cette bonne intention est problématique. La mobilisation et la distribution du foncier collectif pourrait-elle être une solution à la question sociale et à la marginalité de la population rurale par la création d’une « classe moyenne agricole » ? L’exemple du développement de l’agriculture saharienne sur des terres de parcours, dans le Sud/Est du Maroc, a produit des résultats tout à fait contraires : consolidant le dualisme agraire, accentuant la polarisation ruraux/non ruraux et renforçant la classe des capitalistes agraire. Des facteurs objectifs, tenant à la diversité et complexité des situations des terres collectives, et subjectifs concernant la catégorie visée pour en faire une « classe moyenne agricole », pourraient se dresser devant la faisabilité de cette bonne intention. Les candidats à cette « classe moyenne agricole » disposent-ils des qualifications requises et seront-ils accompagnés et dotés en moyens financiers, techniques et manageriels pour réaliser des projets agricoles viables et productifs sur les terres qu’on leurs aurait attribuées ? L’espoir et le doute sont permis.
Continuer à lireFood Security in Tunisia: A Need to Move Back to Sovereignty
Since the end of French colonization in 1956, successive Tunisian governments have managed to ensure access to healthy and sufficient food for the vast majority of its citizens. Tunisia has a low level of hunger, with a 2018 score of 7.9 out of 50 on the Global Hunger Index (GHI), and this number has continued to trend downwards. Most Tunisians eat their fill and some even allow themselves luxury food products from time to time. Physical access to something to eat without too much trouble is not the challenge. The question is, given the context of a stagnant economy and high unemployment: at what cost?
Continuer à lireInterview avec le Sociologue Ruraliste marocain Mohamed Mahdi
-Habib : On est aussi chez toi, pour toi c’est quoi ici ? On est où ici pour toi ?
-Mohamed Mahdi : Ici c’est une maison familiale, c’est mon père qui l’a construite en 1953. C’est une maison en pisé. On venait ici toutes les vacances d’été, à l’époque on avait 3 mois de vacances. Après bien sûr quand on a grandi, les liens sociaux se sont, un petit peu, rompus avec le lieu mais mon père a toujours continué à y venir et donc à entretenir la maison ; pour entretenir il faut habiter. C’est ainsi que cette maison a pu se conserver.
En fait, je n’ai pas totalement coupé les liens avec le pays parce qu’en 1979-1980 j’ai réalisé un mémoire de fin d’étude, qui s’appelait à l’époque DES (diplôme des études supérieures), sur la tribu. C’était une monographie, avec à la fois un peu d’histoire orale mais aussi de la sociologie de cette région.
[…]
Continuer à lireCovid-19 et les routes du capital
Le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2, deuxième virus du syndrome respiratoire aigu sévère depuis 2002, est désormais officiellement une pandémie. Depuis la fin du mois de mars, des villes entières sont confinées et, un à un, les hôpitaux du monde font face à embouteillage médical provoqué par l’augmentation du nombre de patients.
Continuer à lireL’avant et l’après Corona Virus : Des enseignements pour l’avenir
Le 27 décembre 2019, un hôpital de Wuhan, capitale de la province du Hubei, informe le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCCPM), et la Commission nationale de la santé, de l’existence d’une pneumonie inconnue . Le 31 décembre, le centre de contrôle de Wuhan admet l’existence de cas de pneumonie inconnus liés au marché de gros de fruits de mer de Huanan. Après le déni et la sanction du médecin qui fut à l’origine de l’alerte dès le 30 décembre 2019, Li Wenliang, ainsi que de ses collègues qui avaient relayé l’information, l’épidémie est prise au sérieux. La Commission nationale de la santé (NHC) à Pékin, a dépêché immédiatement des experts à Wuhan. Le 8 janvier 2020, la cause de la pneumonie est identifiée comme étant un nouveau coronavirus.
Continuer à lireLa Pandémie Covid-19 : Crise sanitaire ou revanche de la terre ?
Il est des évènements naturels ou non qui marquent l’histoire et la mémoire collective, pour des raisons particulières liées, généralement, soit aux processus et phénomènes qui en sont à l’origine, soit aux conséquences, souvent dramatiques, qui impactent plus ou moins durablement l’espace et/ou la société : les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations et les sécheresses, les épidémies, les guerres et les divers mouvements sociaux, etc., ne sont que des exemples les plus évidents parce que visibles et audibles.
D’autres peuvent, si l’on n’y prend garde, s’inscrire dans la mémoire collective seulement comme un simple moment relativement court avec un déclenchement, un pic et une chute et dont les conséquences, parfois dramatiques, ne sont « visibles » que pendant un temps précis avant que le rideau de l’oubli ne tombe comme l’évidence la plus absolue.
Covid-19 est un exemple particulièrement parlant et significatif de ces phénomènes. Certes, cela ressemble à beaucoup d’égards à une sorte de grippe violente, sans l’être réellement. C’est, du reste, comme cela que cette maladie a été présentée dans un premier temps : une grippe particulière qui menace particulièrement les personnes âgées et celles souffrant de maladies de longues durées, telles que le diabète ou les problèmes cardiaques